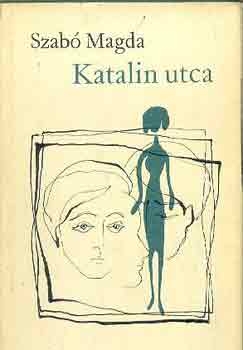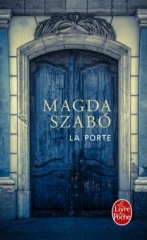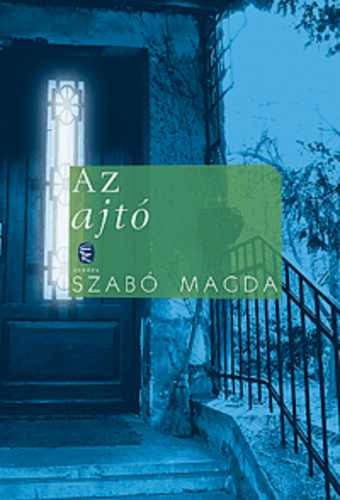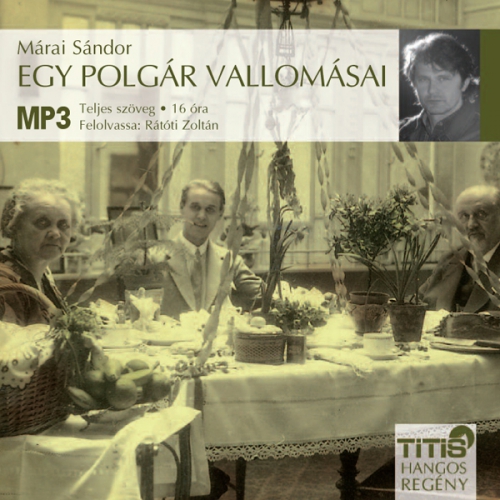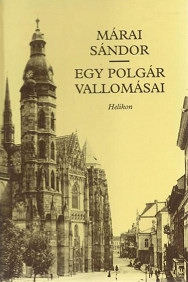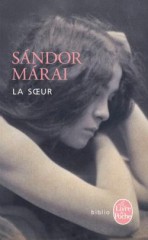Rue Katalin (1969, traduit du hongrois par Chantal Philippe) est un roman antérieur à La Porte, le roman de Magda Szabo à travers lequel j’ai fait connaissance l’an dernier avec cette grande romancière (1917-2017). Dans ce roman-ci déjà, les liens entre les personnages sont très forts, une liste préliminaire les présente comme au début d’une pièce de théâtre : les Biró, les Elekes, les Held et enfin Paul, le seul à ne pas avoir connu la rue Katalin où tous les autres habitaient, partageant un passé qui s’est « désagrégé ».
Ils n’habitent plus là, mais dans un immeuble récent au bord du Danube où ils partagent un appartement auquel aucun d’eux ne s’habitue, même s’ils ont gardé une partie de leur mobilier. Des pièces trop petites, pas de jardin. Seule Kinga, la fille d’Irén et Paul, y vit « dans la gaîté et l’insouciance ». Henriette qui est morte – on découvrira plus tard quand et comment – les rejoint, invisible, « car elle savait que sans les morts, leur quête était vaine, ils ne retrouveraient jamais la rue Katalin. »
Blanka, la sœur d’Irén, a trouvé refuge sur une île où elle dort mal à cause de la canicule. Son mari et sa belle-mère sont indulgents devant sa nervosité et savent qu’elle se sent mieux quand elle se repose au jardin – « la maison était entourée de palmiers, de lauriers, de myrte et de vieux oléandres ». A elle aussi, Henriette rend visite.
Enfin, Henrielle « retournait souvent chez elle et beaucoup l’enviaient. Il n’était pas donné à tous de s’en retourner (…) ». Son ancienne maison et la rue Katalin « entre l’église et le puits turc », elle a dû les rebâtir telles qu’elles étaient avant la guerre, avant qu’on réunisse les maisons et les jardins de ces trois familles en un seul foyer social – leur jardin de roses a fait place à une simple pelouse aux rares massifs de fleurs.
Après les « Lieux » viennent six « Moments et épisodes » de leur vie à tous, sur une trentaine d’années. En 1934, Henriette Held avait six ans quand ils s’étaient installés à Budapest : son père avait acheté la maison à côté de celle d’un vieil ami, le commandant Biró, et de celle de ses voisins, la famille du directeur d’école Elekes. Ses deux filles, Irén et Blanka Elekes, la brune et la blonde, avaient été présentées à Henriette comme ses « amies », puis elles s’étaient retrouvées à jouer au jardin avec Bálint, le fils du commandant, l’aîné des enfants, qui avait tout de suite pris son parti et était devenu son protecteur.
Parfois, ce n’est pas Henriette mais Irén qui raconte, l’aînée des soeurs Elekes, la disciplinée, la bien élevée, alors que Blanka désobéit et pique des colères. Leurs parents, si dissemblables qu’enfant, elle leur avait demandé un jour pourquoi ils s’étaient mariés, s’aimaient – « l’amour fou qui précipite deux êtres l’un vers l’autre, qui assemble les couples les plus improbables ». Irén était aussi appliquée et précise que son père, elle marchait sur ses traces. Amoureuse de Bálint, elle l’épouserait, il deviendrait un grand médecin, pensait-elle depuis toujours.
1944, 1952, 1956, 1961, 1968. « Avec le temps, va, tout s’en va » – les mots de Léo Ferré s’accordent bien à ce roman qui refuse la nostalgie tout en s’attachant à faire comprendre combien ces gens-là ont été heureux ensemble, avant la guerre, et à quel point celle-ci a troublé le cours de leur vie à tous. Irén était jalouse de l’attention de Bálint pour la fragile Henriette, et c’est Blanka qui, sans le vouloir, va déclencher les foudres du destin.
« Publié en 1969, pétri de tristesse et de nostalgie, Rue Katalin traverse plus de trente ans de l’histoire hongroise, entre 1934 et 1968, avec un chapitre où est évoquée l'insurrection de 1956. « Perdre la jeunesse est effrayant, non par ce qu’on y perd mais par ce que cela nous apporte : la conscience que tout se décompose », écrit Magda Szabó. » (André Clavel dans L’Express)
Rue Katalin, à travers les événements vécus par ces trois familles si proches, évoque la vie à Budapest et les transformations sociales au temps du communisme. Magda Szabó, en faisant cohabiter les vivants et les morts, montre de façon souvent touchante, avec des détails précis, comment le souvenir de ceux que nous aimions est une forme de résistance au temps qui passe, une façon de se retrouver dans une autre dimension de la vie.